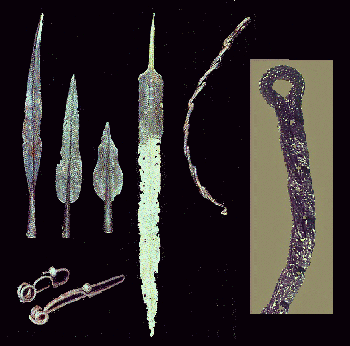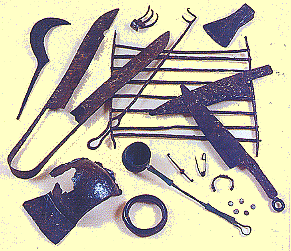
La Tène moyenne : 250 à 150 av. J.-C.
Une économie en
pleine transformation
A partir du II e siècle, tandis que Rome s'assure le
contrôle de la totalité du bassin occidental de la Méditerranée,
les communautés celtiques changent de forme d'organisation.
En moins de un siècle, de véritables petits Etats autonomes
se mettent en place. L'émergence d'une organisation plus complexe se
réalise à la faveur de progrès importants dans le domaine
de l'agriculture. Beaucoup de techniques et d'outils agricoles apparaissent
à cette époque: faux, socs d'araire en fer, coutres, râteaux.
Le paysage lui-même se modifie; l'empreinte de l'homme est visible sous
la forme de ces limites de champs, haies et fossés, qui servent à
drainer les sols et à séparer les différentes zones d'activité:
cours de fermes, champs cultivés, champs laissés en jachère,
pâturages.
C'est, en fait, l'ensemble de l'économie qui se transforme. La monnaie se généralise: sa valeur est une convention garantie par l'autorité émettrice.
De gros bourgs, sièges d'activités artisanales et commerciales, se constituent. Il s'agit d'agglomérations ouvertes, d'une dizaine d'hectares. Plusieurs ont livré des preuves de fabrication de monnaies. Toutes regroupent des activités artisanales très spécialisées dans le travail de l'or, du bronze, du fer, du verre, de l'os, ou dans la poterie.

-
Au IIIe siècle :
nouvelles incursions et installation des tribus allobroges
Il n'est pas dans notre intention d'aborder le problème de l'origine des Allobroges
qui est plus du domaine de l'historien que de celui de l'archéologue, encore
que celui-ci puisse reconnaître la provenance de certains objets ou des influences
techniques et culturelles (sur cette question voir W. Kruta 2000).
L'occupation du territoire est marquée par des oppida, des habitats, des tombes,
des dépôts et des monnaies : force est de reconnaître leur relative rareté
, mises à part les monnaies exceptionnellement abondantes.
Pourtant en 121, les Allobroges battus au confluent de l'Isère et du Rhône
par Fabius Maximus perdent 120.000 hommes selon Tite-Live, 130.000 selon Pline,
150.000 selon Orose et 200.000 selon Strabon (G. Barruol 1969 p. 108). Fussent-ils
très exagérés ces chiffres disent assez la grosseur des contingents
qui pouvaient être recrutés en
Allobrogie, Gaulois et autochtones réunis. Cela suppose une population importante
que les seuls vestiges archéologiques ne traduisent absolument pas. Pour compléter
nos connaissances, pour mieux matérialiser l'extension de l'occupation et
la mise en valeur du pays, nous avons eu recours aux toponymes, éléments assez
aisément identifiables et encore bien conservés dans nos campagnes .
La Tène moyenne
Archéologie
Quelques tombes de soldats marquent une première occupation du massif de Crémieu
(inhumation plate avec épée non ployée à Crémieu), de la vallée de
la Bourbre (inhumation plate à Châbons), de l'entrée de la cluse
de Grenoble (incinérations à Rives avec épées ployées et à Voreppe
avec épées non ployées), en Albanais à Rumilly et de la Combe
de Savoie (inhumation plate avec épée non ployée à Cruet), cernant
ainsi le futur territoire allobroge. Rives offre un remarquable baudrier porte-épée
par son travail de ferronnerie, celui de Voreppe étant plus ordinaire.
Cette vague gauloise de la région de Grenoble est-elle différente
de celle des tribus du Dauphiné du nord et de Suisse où les incinérations
sont inconnues à la Tène moyenne ? C'est probable, ce qui tendrait à
vouloir dire que le peuple des Allobroges rassemblaient des tribus assez différentes.
Les frontières découvertes à l'intérieur de l'Allobrogie
semblent le confirmer. La coutume de ployer l'épée du soldat
est-elle aussi une caractéristique tribale ?
la Tène finale
Archéologie
La présence de guerriers
à l'entrée de la Cluse de Grenoble est particulièrement significative car
il existait dans la région grenobloise un peuplement autochtone caractéristique
(groupe de Rochefort) ayant des liens avec
les alpins de l'Oisans et du Queyras.
Ces indigènes devaient être particulièrement surveillés car ils n'étaient
probablement pas favorables à la présence gauloise et de plus ils bloquaient
l'accès du Sillon alpin et une des voies principales de pénétration dans les
Alpes. Aucun élément archéologique du groupe de Rochefort est postérieur à
la Tène ancienne, ce qui prouverait l'assimilation rapide par les Allobroges
de cet isolat alpin,
si bien situé stratégiquement.
"Lorsqu'une tribu s'installait dans une région, ce dut être en général assez
brutalement, mais elle n'éliminait pas pour autant systématiquement les autochtones
propriétaires du sol : bien plus elle se mêlait à eux au point que quelques
générations après, l'osmose était totale entre les indigènes et les nouveaux
venus.".
Le domaine alpin continue
à recevoir des bijoux gaulois : des fibules à St Jean-de-Belleville, St Jean-d'Arves,
St Sorlin-d'Arves, Jarrier et une splendide ceinture à Jarrier, d'un modèle
habituel en Celtique danubienne.
Les tombes de guerriers des IIe et Ier siècles sont localisées dans l'Isle
Crémieu à Creys-Mépieu, Optevoz, Vernas (et une probable à Bourgoin),
région clé pour les Gaulois sur laquelle nous reviendrons et une près de Lyon
(Genas).
Le nombre de sites fouillés
étant restreint, on connaît mal la céramique de fabrication locale (Seyssinet-Pariset,
Sassenage, La Balme-les-Grottes) ; celle d'importation (ateliers de Roanne,
italiques) est présente à Aoste, Larina, Vienne, Genève, Annecy, etc.. Des
recherches restent à faire dans ce domaine.
L'intérieur des Alpes récèle peu de matériel de la Tène finale, mis à part
des tombes au pied du col du Montcenis, à Lanslebourg et cela paraît étonnant
: cela est-il dû à une " baisse du niveau de vie " des populations locales
?
Deux importants dépôts d'objets en fer (outils d'artisans,
culinaires ou agricoles, parures, etc.) proviennent de Vienne (Ste Blandine)
et de Hières -sur-Amby (Larina) ; ils renseignent sur les activités quotidiennes
et les techniques d'élaboration des outillages.