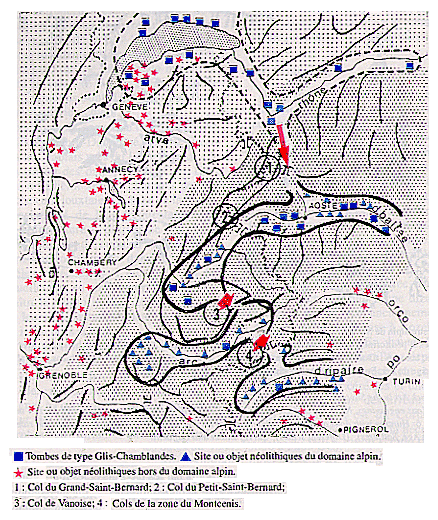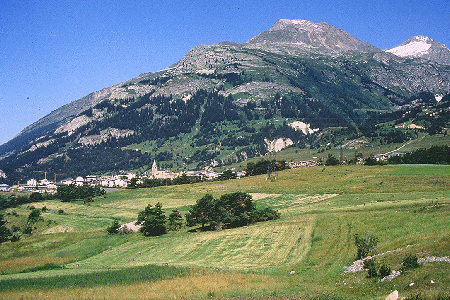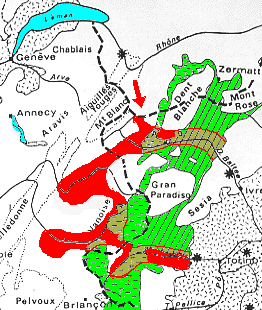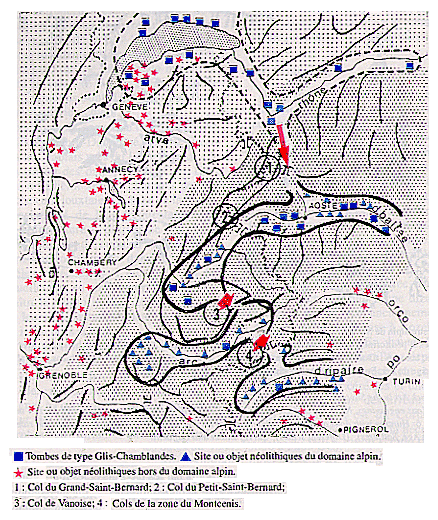
S'il est un exemple où archéologie, géographie et géologie sont étroitement liées c'est la région des vallées supérieures de l'Arc et de l'Isère en Savoie, et celles des Doires Baltée et Ripaire sur le versant italien, là où se met en place le premier peuplement de la haute montagne, au coeur des Alpes.
L'archéologie
Quels sont les faits archéologiques : sur une centaine de trouvailles
ou sites néolithiques de Savoie, près d'une cinquantaine se
placent en Maurienne et en Tarentaise, densité élevée
peu commune pour des régions montagnardes. Cette évidence atteste
une forte implantation humaine pour laquelle on est en droit de se poser des
questions. En plus, ces derniers vestiges sont exclusivement localisés
à la partie haute des vallées, en amont de Moûtiers sur
l'Isère, en amont de Saint-Jean-de-Maurienne sur l'Arc.
En haute Tarentaise, à Aime, une nécropole avec tombes de type
Glis-Chamblandes est datée de 3450 BC ; la datation qui ne concerne
qu'une tombe, ne fixe pas la durée d'utilisation de la nécropole
riche de plus d'une dizaine de coffres. D'autres avaient été
ancien-
nement découvertes à Aigueblanche. En plus d'un vase à
Bozel, ce
sont tous des éléments de la civilisation helvétique
de Cortaillod.
En haute Maurienne, les Balmes de Sollières, fouillées depuis
1978
par P.Benamour, ont livré un récipient en écorce de bouleau
contenant
des céréales et une pendeloque de type Port-Conty dans des niveaux
datés de 3660 BC et 3400 BC; c'est encore un Cortaillod récent
en
accord chronologique avec la nécropole d'Aime et les dates du Valais
(3800 à 3200 BC).
Au Néolithique moyen ces deux régions présentent
donc une impré-
gnation culturelle identique par le faciès valaisan et vaudois de la
civilisation de Cortaillod avec tombes et matériels caractéristiques.
Or entre Tarentaise et Maurienne les communications sont aisées par
le col de la Vanoise qui relie l'Isère et l'Arc, voie fréquentée
depuis
toujours par les paysans et les marchands locaux.
L'origine directe de ce peuplement savoyard se trouve sur le versant oriental
italien, en Val d'Aoste sur le cours supérieur de la Doire Baltée,
lui-même arrivé du Valais suisse à travers le col du Grand-Saint-Bernard
comme en témoignent huit nécropoles à multiples coffres
Glis-Chamblandes.
Dans le Val de Suse, la nécropole de Chiomonte-la Maddalena et son
habitat avec céramique Cortaillod, datés de 4000 à 3600
BC, ont la même provenance culturelle. Entre les portions supérieures
du Val d'Aoste et du Val de Suse il n'existe aucune possibilité de
communication aisée à travers les chaînes orientées
Ouest-Est ; le Val de Suse a dû être atteint à partir de
l'est par l'intermédiaire de la Tarentaise puis de la Maurienne.
L'unité culturelle alpine se retrouve aussi dans l'art rupestre gravé
sur les blocs erratiques et les dalles polies par les glaciers : les motifs
ont de grandes similitudes avec ceux, aussi très abondants, du Val
de Suse et du Val d'Aoste. La parole est aux spécialistes de l'art
qui pourraient nous en dire plus sur les concordances dont les études
sont en cours.
La
géographie
La géographie explique l'isolement et l'identité culturelle
que démontre l'archéologie : ces deux régions, haute
Maurienne et haute Tarentaise, communiquent avec le Sillon alpin à
l'Ouest par 30 à 40 km de gorges profondes qui entaillent des terrains
métamorphiques durs. Les parois abruptes, le fond étroit et
les rivières tumultueuses rendent le passage quasi impossible sans
infrastructures, même si quelques sentiers précaires et malaisés
ont été tracés sur les pentes boisées inhospitalières.
Aujourd'hui encore ces gorges recèlent peu de villages.
Par contre en amont, les roches
plus tendres ont été modelées en relief adouci par les
érosions glaciaires et offrent des bassins étagés propices
à l'habitat, à la culture et à l'élevage sur des
replats ensoleillés ; des cols aisément praticables, le Petit-Saint-Bernard
et ceux de la zone du Mont-Cenis, les font communiquer sans difficulté
avec le Val d'Aoste et le Val de Suse.
La barrière à la pénétration humaine à
partir du Sillon alpin s'établit non pas à la ligne de partage
des eaux placée sur les plus hautes crêtes, sur la frontière
actuelle, mais bien plus à l'Ouest au niveau de la chaîne granitique
des massifs centraux qui s'étend entre le Mont-Blanc et Belledonne,
seulement entaillée par l'Arc et l'Isère.
F.Fedele dès 1976 puis A.Bertone en 1990 ont déjà défini
une unité entre les vallées de l'Arc, de la Doire Baltée
et du Chisone remarquant "que les gisements se concentrent dans les
parties moyennes et hautes des vallées et des vallons latéraux,
zones placées en amont des sillons morphologiques caractérisés
par un accès difficile à partir de la plaine", bien
que le Val de Suse s'ouvre sans contrainte géographique majeure sur
la plaine piémontaise.
J'irai plus loin que mes collègues italiens en rassemblant les quatre
hautes vallées alpines, celles de la Doire Ripaire, de la Doire Baltée,
de l'Arc et de l'Isère après avoir dit que leur peuplement initial
provient du haut Rhône en Suisse, entre 4000 et 3500 BC. C'est le début
d'une entité alpine disposée de chaque coté de la ligne
de partage des eaux et des cols transalpins sur des terroirs favorables à
une économie agro-pastorale, à une époque où le
climat était plus clément que l'actuel (91).
Les
ressources minérales
Un peuplement établi dans de telles conditions peut surprendre car
pourquoi affronter les difficultés de l'altitude et du climat alors
que les terres vierges et fertiles ne manquent pas autour des montagnes, aux
conditions plus clémentes pour les agriculteurs ?
Il s'explique bien, par contre, si on envisage l'exploitation, dès
le Néolithique moyen, des roches vertes abondantes et variées
dans ces régions ; n'oublions pas que la plupart des lames polies trouvées
entre Rhône et Durance, sans parler des zones plus lointaines où
elles ont diffusé au Nord, à l'Est et à l'Ouest, proviennent
des "schistes lustrés alpins". On en retrouve jusqu'en
Bretagne (92).
L'exploitation des roches vertes a-t-elle induit le peuplement de la haute
montagne ou bien n'est-elle que la conséquence d'une occupation motivée
par d'autres raisons ? Un argument fait pencher pour la première hypothèse
car les tombes de type Glis-Chamblandes ne débordent pas, vers l'est,
la limite géologique des gîtes de roches vertes tant dans le
val de Suse qu'en val d'Aoste.
Par contre, la haute Tarentaise ne possède pas de gisement de roche
dure, contrairement à la Maurienne avec l'atelier de Bessans, et il
faut admettre ici une occupation sans raisons "industrielles". Toutefois
cette présence était possible et permettait de faire le lien
entre le Val d'Aoste avec la Maurienne et le val de Suse...
Au Néolithique moyen les
hommes s'installent donc bien sur les zones de roches nécessaires à
la fabrication des lames de hache indispensables à l'économie
néolithique.
L'évolution
du "domaine alpin" d'altitude
Mais pour homogène que soit son peuplement lors de sa formation, cette
région a été en contact précoce avec des influences
extérieures, probablement comme conséquence des échanges
liés à l'exportation des haches polies.
Au Néolithique moyen
: influences chasséennes
La grotte des Balmes à Sollières
a livré quelques tessons d'allure chasséenne associés
à des dentales de la Méditerranée.
Sur le versant italien, la vallée de Suse, à Chiomonte-la Maddalena
et San Valeriano à Borgone-di-Susa, possèdent aussi de la céramique
chasséenne tardive (93),
des lames et lamelles en silex provenant de la basse vallée du Rhône
ou de Provence et même de l'obsidienne sarde.
Se pose le problème de la voie de leur arrivée car la Maurienne
ne semble pas encore ouverte à l'ouest vers le Sillon alpin, ce qui
laisse penser que le Chasséen méridional est parvenu à
partir du versant italien. Deux possibilités s'offrent alors : soit
le tracé occidental de la Durance par le col du Montgenèvre
vers la Doire Ripaire puis, dans un mouvement récurrent, vers la haute
Maurienne par les cols du Mont-Cenis ; cette voie a la préférence
de F.Fedele à laquelle s'oppose le fait que Briançonnais et
haute Durance n'ont toujours pas livré de sites chasséens qui
traduiraient une présence au Néolithique moyen.
La deuxième hypothèse serait une remontée de Chasséens
sur le versant oriental des Alpes à partir des sites de Ligurie puisque
le Piémont, la plaine du Pô et même l'Emilie les connaissent
assez largement ; plusieurs spécialistes piémontais adoptent
actuellement cette opinion.
Au Néolithique final
Les contacts des vallées savoyardes avec la Lombardie sont marqués,
entre 3000 et 2500 av. J.C., par quelques témoins de la
civilisation de Remedello à Fontaine-le-Puits en Tarentaise,
avec la première présence du métal au coeur des Alpes
françaises. Aux Balmes de Sollières une plaquette en nacre et
un vase à métope incisé se rattachent à la même
influence.
La Maurienne possède des éléments du Néolithique
final : parures (94)
et alêne losangique en cuivre à Sollières-Sardières
avec une date de 2500 BC. Méridionales aussi pourraient être
les 17 lames trouvées avec de nombreux ossements (ossuaire collectif)
au pied d'un rocher à Fontcouverte en Maurienne. Ces témoins
sont à rapprocher de l'ossuaire en grotte à Boira Fusca (vallée
de l'Orco) et de la tombe collective d'Alto (Val Varaïta) à forte
saveur méridionale (95)
et des vases à cordons horizontaux languedociens de Chiomonte en Val
de Suse et de Roure-Balm'Chanto (datés de 2570 BC) en Val Chisone.
Comme à Modane dans une cavité et à Foncouverte, à
l'ouest du lac de Garde, le rite funéraire habituel est la tombe collective
en grotte ou en abri sous roche.
Pour atteindre les vallées piémontaises le courant venu du Midi
est-il passé par la Durance et le col du Montgenèvre ; c'est
probable car nous n'avons pas encore de preuve du désenclavement vers
l'ouest des hautes vallées savoyardes et ce faciès culturel
est absent de la Combe de Savoie et du Grésivaudan en amont de Grenoble,
zone qui aurait pu servir de relais.
En outre nous savons que dans les Hautes-Alpes le Néolithique récent
méridional est très largement représenté, remontant
jusqu'au col du Montgenèvre ce qui n'était pas le cas au Néolithique
moyen.
Il
est possible que le plateau d'Arvan, au sud de St-Jean-de-Maurienne, ait été
colonisé assez tard, à la fin du Néolithique, mais à
partir de l'amont.
Les montagnards ont une vieille histoire...
Des populations établies en altitude sur les versants occidental et
oriental ont prospéré pendant des millénaires dans les
bassins élevés, reliés entre eux par de nombreux cols,
profitant de la clémence du climat qui régnait à la fin
de la période de l'Atlantique.
Cette implantation permanente, déterminée à l'origine
par l'exploitation des roches vertes, a mis en valeur la haute montagne alpine,
malgré les péjorations climatiques ultérieures auxquelles
il fut fait face avec de grandes capacités d'adaptation ; les premiers
Alpins ont su se plier aux dures réalités montagnardes et tirer
profit des ressources et des voies de communications.