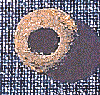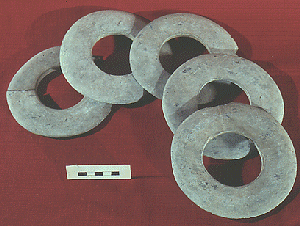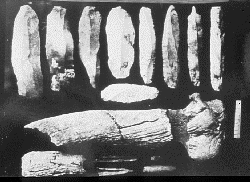
Atelier de taille du silex
suivant la technique pressignienne :
en haut : les déchets de silex
en bas : nucléus dits " livre de beurre".
Vassieux-en-Vercors
Le cuivre et les mines
Le cuivre s'est diffusé lentement en
Europe occidentale à partir de quelques centres de production de Suisse
nord-orientale, Italie du Nord, Languedoc, etc. dès la fin du IVe millénaire.
C'est dire que les populations avaient connaissance des objets métalliques,
même si elles ne pouvaient pas toujours les acquérir.
A Charavines le premier métal alpin bien daté, entre -2670 et
-2590, est représenté par deux perles dont une en cuivre stibié
d'origine languedocienne et deux petits poinçons bipointes. Haches
et poignards en cuivre faisaient rêver ceux qui se contentaient des
outils de pierre que le nouveau matériau était appelé
à faire disparaître. Pour résister à cette concurrence,
les tailleurs de silex et les façonniers de lames polies ont montré
un grand savoir faire.
Dans les Alpes, la seule preuve de l'exploitation des mines de cuivre au Néolithique
final est celle d'un filon à Saint-Véran, Hautes-Alpes, avec
des traces de métallurgie prouvées par des creusets et des tuyères.
Les métallurgistes devaient venir d'Italie du Nord comme le prouve
les gravures de poignards "Remedello" à Saint-Paul-sur-Ubaye,
à six km de Saint-Véran.
Mais bien d'autres, parmi les nombreux gites de cuivre, ont pu être
exploitées, tant dans les Hautes-Alpes (région de Gap), la Drôme
(Les Baronnies) ou la Savoie en Tarentaise : de ces régions proviennent
de nombreux objets de cuivre...
Les rites funéraires du Néolithique
Dans
une couche chasséenne, un dolicocéphale de type méditerranéen
(70), à Fontaine, était inhumé
dans une fosse en position repliée sur le côté gauche
; il y avait autour les restes épars de six individus de petite taille.
J'ai évoqué les tombes localisées sur la rive Sud du
Léman caractéristiques du type de Glis-Chamblandes : ce sont
des coffres de dalles contenant plusieurs corps en position latérale
souvent repliée.
Complétons par l'ossuaire collectif en grotte de la Balme-les-Grottes
qui comportait des tessons chasséens avec deux vases attribués
à l'influence du
Néolithique moyen bourguignon.
Néolithique
moyen bourguignon.
A la Balme-de-Sillingy, près d'Annecy, des corps
malheureusement sans mobilier étaient allongés sur le dos en
deux groupes sur le sol d'une grotte: ils sont datés de 3050 BC et
2220 BC.
Toujours sans mobilier, un corps, avec la même disposition, dans une
fissure de rocher obturée volontairement par un bloc, date de 3100
BC à Saint-Paul-de-Varces au Sud de Grenoble. Dans ces deux derniers
cas on n'est pas étonné de l'absence de mobilier car ils correspondent
à une période où aucuns caractères culturels ne
peuvent être discernés, après le Néolithique moyen
et avant les influences de la Civilisation Saône-Rhône.
Aucune sépulture n'est attribuable avec certitude à la civilisation
Saône-Rhône;
je lui rattache pourtant le groupe funéraire de Saint-Quentin-Fallavier
en Nord-Dauphiné placé au coeur d'une région aux terres
lourdes et marécageuses plus conformes aux habitudes des "Saône-Rhône"
que des Méridionaux. Nous sommes en présence d'un cimetière
et non d'une nécropole collective, car plusieurs tombes individuelles
plates, entourées de dalles, étaient alignées sur le
côté Est d'un bloc erratique portant de nombreuses cupules. Le
mobilier comportait de longues perles en lignite, une pioche en bois de cerf
et des lames de silex assez irrégulières qui ne rappellent en
rien celles venant du Midi ou du Grand-Pressigny.
La civilisation de Remedello
est à l'origine à Fontaine-le-Puits,
Tarentaise, de plusieurs sépultures
individuelles (71) parfaitement conformes aux
tombes remedelliennes anciennes de la région lombarde.
Les ossuaires collectifs inspirés par le Néolithique récent méridional sont nombreux dans le Sud du Dauphiné (Drôme, Ouest des Hautes-Alpes et Isère) et remontent jusqu'au lac du Bourget; ceci est en accord avec la dispersion que nous avons vue pour les sites habités. Leur âge va de 2875 à 2310 BC. Ils sont en grottes dans les pays calcaires ou en hypogées artificiels sur les terrains molassiques des collines du piedmont (72). Les silex (flèches, lames) et les parures de ces tombes sont toujours d'origine méditerranéenne.
Les ateliers de taille
du silex
En Vercors existent de nombreux gisements de silex dans
les roches calcaires ou dans les sables des grottes: certains, dans la partie
méridionale du massif, ont été exploités tout
au long du Néolithique . D'autres sont inclus dans l'argile et exploités
en ateliers disséminés sur des centaines d'hectares pour extraire
des lames suivant des techniques utilisées spécifiquement au
Grand-Pressigny; ils ont laissé sur place d'énormes quantités
de déchets et de nucléus en "livre de beurre". La
plupart des sites qui ont reçu les produits de ces très importants
ateliers nous sont inconnus mais on dispose depuis peu d'indications du plus
haut intérêt : quelques
lames de silex d'Autrans ont été retrouvées dans des
niveaux Horgen (datés entre -3107 et -3093) et d'autres en silex de
Vassieux avec un contexte Saône-Rhône (datés entre -2780
et -2701), à Portalban sur le lac de Morat en Suisse occidentale. Ces
déterminations récentes montrent que le silex du Vercors était
exporté loin et les dates précisent le terminus post quem
de la mise en exploitation de ces ateliers, c'est à dire la fin du
IVe millénaire; cette ancienneté peut surprendre car au Grand-Pressigny
même il n'y a pas de dates aussi hautes et la question peut se poser
maintenant de savoir qui, du Vercors ou de la Touraine a initié la
taille pressignienne...
Le
Vercors a fourni d'autres sites de taille avec des productions fondées
sur des techniques bien différentes: faciès
macrolithique (Villard-de-Lans, Vassieux), montmorencien (Vassieux) et
campignien (Vassieux).
Les richesses de ce massif en gîtes de silex ont attiré durant
toutes les époques des artisans dont les fabrications ne sont pas situés
chronologiquement avec précision.
De plus, mises à part les basses vallées marginales, en Vercors,
aucun site d'habitat n'a encore était indidualisé, qui serait
l'indice d'une implantation permanente ; ce dont on dispose actuellement fait
penser plus à des exploitations temporaires ou saisonnières.
Dans le Diois et à l'Ouest des Hautes-Alpes les tailleurs de silex
ont rivalisé d'habileté pour imiter les lames métalliques
en fabriquant des couteaux dits "pointes de Sigottier" en silex
local à la fin du Néolithique et au début de l'âge
du Bronze, dont l'usage restera limité à la Drôme orientale
et à l'Ouest des Hautes-Alpes.
Les roches vertes ou tenaces
Si
certaines petites lames polies ont pu être confectionnées à
partir de galets issus des moraines et des alluvions qui s'étalent
dans les plaines, les pièces plus grandes qui apparaissent, probablement
dès la fin du Néolithique ancien et certainement au Néolithique
moyen, sont issues des centres de fabrication implantés sur des gisements
de roches vertes de bonne qualité.
Tout un commerce et des techniques de fabrication sont encore à découvrir
par l'analyse pétrographique fine des haches polies et des gîtes
de roches dures alpines.
On sait déjà que des ateliers installés sur les schistes
lustrés du Val d'Aoste (Excenevex), du Val de Suse, du Val de Lanzo,
du Val Chisone (Barge), encore bien peu connus ou pas étudiés,
ont fourni beaucoup de haches polies de la Suisse rhodanienne et du Sud-Est
de la France. Ces ateliers ont été exploités par des
populations installées de manière permanente et il est probable,
comme j'en donnerai les raisons, que ces outils si recherchés ont transité
par le Grand-Saint-Bernard vers le haut Rhône pour alimenter le domaine
de la Civilisation Saône-Rhône (la pétrographie prouve
l'origine italique des haches de Charavines). Dans le travail des roches vertes
le Val de Suse, le Val Chisone et la haute Maurienne se sont fait une spécialité
avec les flèches losangiques polies qui se retrouvent en Valais, à
Annecy et à Charavines ; ceci confirme la voie envisagée pour
la diffusion des haches italiques vers le haut Rhône et de là
vers les Alpes du Nord .
De récentes études pétrographiques montrent que des lames
polies chasséennes du Sud du Dauphiné et du couloir rhodanien
proviennent de la Vallée de Cunéo et du Mercantour, probablement
par le Mont-Genèvre ou le Queyras. Dans la Drôme, à la
Bégude-de-Mazenc et en Diois à Charens, deux dépôts
de haches polies ont vraisemblablement la même origine. Ils rassemblent
des haches terminées (respectivement de 10 et 13 lames) mais jamais
utilisées; leurs dimensions comme leur qualité indiquent qu'elles
ont été taillées dans des ateliers installés sur
les affleurements mêmes de roches vertes. A la Bégude certaines
sont très longues, jusqu'à 35cm, et 7 d'entre elles portent
un piquetage annulaire pour une fixation sans gaine en bois de cerf que l'on
retrouve aussi sur quelques pièces régionales.
Exceptionnels
sont les six grands anneaux-disques en ophiolite polie de Chambéry,
trouvés ensemble et pour qui se pose le problème de leur origine:
objets uniques dans le Sud-Est, à quelle
civilisation les attribuer? Bien connus dans celles de Vho et Fiorano
dans la plaine padane, il en existe de semblables à Turin ; est-ce
là qu'il faut en chercher la provenance ?