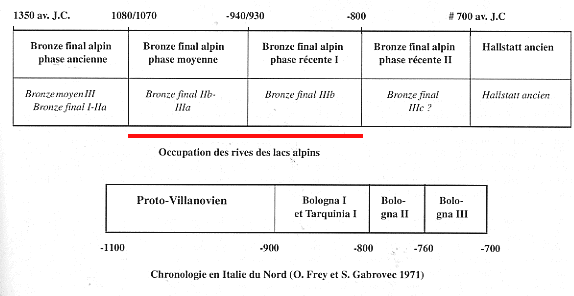
Quatre millénaire de conquête progressive des Alpes ont permis aux Alpins d'explorer toutes les possibilités d'implantation et de circulation et aussi de découvrir les richesses minérales qu'un jour ou l'autre on saura exploiter.
La mise en valeur et l'organisation
territoriale vont maintenant faire un bond, prendre une dimension jusqu'alors
inconnue et tendre vers une uniformisation des techniques, des traditions
et probablement des substrats humains.
Après la "crise" climatique, technique et humaine de l'âge du Bronze moyen,
les Alpes du Nord seront un espace fragilisé où pourront se développer sans
contraintes ni opposition les influences externes et je ne disserterai pas
pour savoir si les migrations ou l'acculturation seule les expliquent ; le
problème est surement bien plus complexe que ne le décrivent les simplifications
caricaturales dont les théoriciens se repaissent depuis 50 ans, les uns pour
les déplacements massifs de population, les autres pour l'acculturation,
sans oublier les influences commerciales ou culturelles. Tout est possible
selon l'époque et les régions, et parfois en même temps
: ce ne sont que cas d'espèce à analyser au coup par coup...
Aux XIVe et XIIe siècles, deux pôles civilisateurs européens auront suffisamment de dynamisme pour diffuser leurs emprises techno-culturelles et/ou s'implanter dans le Sud-Est de la France : l'Italie du Nord et l'Europe moyenne. Les influences méridionales ne se feront plus sentir pendant toute la fin de l'âge du Bronze.
L'histoire des Alpes du Nord
sera marquée, jusqu'à l'âge du Fer, par cette dualité des influences qui favoriseront
l'éclosion d'une civilisation alpine où ces sources, domaine nord-alpin et
domaine italique, se retrouvent toujours mais mêlées à une bonne dose d'originalité
régionale.
La multiplication des gisements archéologiques à la fin de l'âge du
Bronze traduit l'accroissement du peuplement. Quelle en est la ou les causes
?
A l'amélioration climatique se joignent des facteurs humains et techniques
: "gens" venus du nord-est (nombreux ou non ?), sédenta-risation permanente
en village que permettent les meilleurs rendements agricoles dus à la diffusion
de l'araire, de l'assolement, etc.
Une certaine uniformisation apparaît dans la vaisselle domestique et aussi
dans la vaisselle fine : les mêmes décors, les mêmes formes et les mêmes évolutions
se retrouveront de part et d'autre des crêtes alpines obligeant les spécialistes
italiens à parler d'influences occidentales pour une certaine partie de leur
matériel.
Cela traduit une unité culturelle et technique des alpins induite par le même
mode de vie adapté aux contingences de la montagne et surtout par les contacts
habituels et fréquents entre les terroirs reliés par les cols. Ces contacts
dus au déplacement des troupeaux, à l'échange des productions agricoles ou
autres, étaient facilités par un climat clément rendant plus aisée la circulation
en altitude.
Témoin privilégié des changements,
la céramique grossière banale et omniprésente subira des modifications de
forme et de décor qui se retrouveront identiques entre plaine du Pô et couloir
rhodanien. Sur le versant français, comme en Piémont, ces modifications sont
difficiles à replacer chronologiquement en l'absence de stratigraphies épaisses
ou de matériel exogène bien daté.
C'est la raison des incertitudes, des imprécisions typo-chronologiques de la fin de l'âge du Bronze et de la première partie de l'âge du Fer, alors qu'en Italie du Nord des séries caractéristiques proto-Golasecca et Golasecca sont associées à cette céramique d'usage, ce qui permet d'en suivre l'évolution et la chronologie précises.
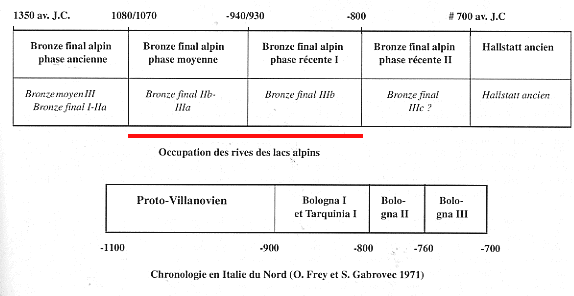
Le cadre chronologique
J.J.Hatt
partageait le Bronze final en cinq phases (B.F. I, IIa, IIb, IIIa, et IIIb).
En ce qui concerne les Alpes du Nord, dès 1976, je les avais regroupées en
trois phases correspondant aux trois faciès techno-culturels majeurs reconnus
dans le matériel régional dont l'âge ne pouvait pas être apprécié plus finement.
Ainsi sont nées nos phases ancienne, moyenne et récente du Bronze final alpin
étant entendu que, lorsque cela est possible, le début ou la fin de la phase
sont précisés. Les limites chronologiques de ce schéma ont été modifiées en
1986 pour s'ajuster aux premiers résultats dendrochro-nologiques (151)
; depuis dix ans nouvelles fouilles et analyses ont encore apporté des précisions
dont il est tenu compte dans le tableau
-Le début de la phase
ancienne ne correspond plus à la fin du Bronze moyen de J.J.Hatt (1250
av. J.C.) : pour moi elle débute au XIVe siècle car je lui incorpore la période
de transition entre Bronze moyen/Bronze final dont j'ai parlé au chapitre
précédent.
En effet c'est à ce moment que commencent la mutation techno-culturelle du
Bronze final et l'essor des échanges avec l'Italie du Nord.
-La phase moyenne, regroupant le Bronze final
IIb et IIIa, était comprise entre 1050 et 850 av. J.C.; en réalité sa durée
fut plus courte, débutant vers -1070 pour se terminer vers -940/-930 au plus
tard (152).
-La phase récente se rapporte au Bronze final IIIb que J.J.Hatt plaçait entre 850 et 725 av. J.C. ; or nous venons de voir qu'elle débute autour de -940/-930, à la fin de la phase précédente.
La phase récente se prolonge
au delà de la destruction des stations littorales autrefois fixée arbitrairement
vers 750 et que l'on sait aujourd'hui légèrement antérieure à -800 au lac
du Bourget (à Chatillon et au Saut de la Pucelle).
Pour prendre en compte leur disparition qui fut un événement historique majeur,
quel qu'en soit la cause, j'ai proposé en 1990 de scinder cette période en
deux parties : une phase récente I avant 810/800
av. J.C., correspondant à la fin du Hallstatt B2 centre-européen, et une phase
récente II jusqu'au Hallstatt ancien vers 700 av. J.C.
Cette bipartition du Bronze final IIIb a l'avantage de subdiviser cette période
bien longue (env. 230 ans) en regard des événements sociaux, géopolitiques
et économiques qui agitent l'Europe au VIIIe siècle.
Cela se traduit par la nécessité où se trouvent nos collègues italiens, suisses
et allemands de partitionner la chronologie en période de moins d'un siècle
pour classer des matériels qui évoluent très rapidement.
Dans l'étude des corrélations
que j'ai faite en 1989 entre les importations italiques et la chronologie
des Alpes du Nord, j'avais été amené à vieillir de quelques décennies le cadre
chronologique italien, pour le rendre plus conforme à nos données dendrochronologiques
de l'époque, ceci sur la base de la disparition des stations lacustres vers
-850/840 que l'on avait parallèlisé, sans beaucoup d'arguments,
avec les dates suisses.
Or les nouvelles analyses en France rajeunissent cette limite vers -814/810
et dès lors la chronologie des matériels de part et d'autre des Alpes se trouve
en totale harmonie, à l'échelle de nos approximations et à quelques nuances
près.
J'ai fait cette étude rectificative trop tôt !
Pourquoi l'installation
sur le bords des lacs ?
Les ateliers de métallurgistes et de potiers
L'installation
des ateliers près des plans d'eau, lacs ou rivières, est un phénomène qui
commence en Europe moyenne : le développement des voies de communication facilite
le transport des matières premières, la croissance des productions et des
échanges nécessite des fabrications de masse pour la conquête de nouveaux
marchés.
On a beaucoup glosé sur le rapport entre l'occupation des rives et les regressions
du niveau des lacs, l'homme s'installant près de l'eau en périodes de "sécheresse".
Si on ne peut nier l'avantage de disposer de terrains plats et dégagés de
végétation après une baisse du niveau de l'eau, je pense que bien d'autres
contingences et de raisons, comme le poids des traditions, les nécessités
techniques ou politiques, interviennent dans le choix de telles implantations.
Ceci outre la commodité que représentait le flottage pour rassembler le bois
des constructions, il faut se rappeler que l'élaboration des bronzes demande
200 à 300 kg de bois pour obtenir un kilo d'objets finis à partir de 10 à
20 kg de minerai riche.
Celui-ci pouvant voyager facilement, il était avantageux de se rapprocher
du combustible là où son transport en grande quantité était facilité par le
flottage.
La cuisson des vases est tout autant gourmande en bois, c'est pourquoi les
ateliers lacustres ont toujours une double vocation, métallurgique et céramique.
De plus la concentration de la production permettait la spécialisation des
artisans potiers et bronziers liée à une haute technologie, sans oublier les
aspects commerciaux qui pouvaient être mieux contrôlés par ceux qu'on appellera
déjà des "industriels".
La chronologie
des installations littorales
Les stratégies de production changent donc progressivement dès le XVe siècle
en Autriche, en Allemagne méridionale ou en Bohème ainsi qu'en Italie du Nord,
à la fin du Bronze moyen et au début du Bronze récent.
Dans les régions de France orientale les ateliers se mettent en place bien
plus tard (153) ; ceux
de Suisse occidentale (en -1107) précèdent ceux de Savoie installés trente
à quarante ans après (environ -1080/-1070). On sait actuellement, d'après
les ramassages et les sondages, que les centres savoyards n'atteignent probablement
pas le nombre ni l'importance de leurs homologues helvétiques. Les sites des
lacs Léman (rive française), d'Annecy et d'Aiguebelette ont livré moins de
matériel que ceux du Bourget mais ce ne peut être dû qu'à la présence de couches
plus profondes que les anciens chercheurs d'antiquités n'ont pas atteintes
ou qui ont été érodées.
Moins nombreux, moins productifs, on ne sait pas, mais de toute façon les
bronziers lacustres se sont trouvés en concurrence avec les producteurs locaux
déjà bien organisés dès la phase ancienne du Bronze final, comme nous le verrons.
La position des stations Certains ateliers littoraux des Alpes du Nord ont été implantés sur des îles ou des presqu'îles (154), pratique rarissime en Suisse ou en Allemagne. Cette volonté de s'isoler de la terre ferme, qui complique autant la construction que les déplacements et la vie quotidienne, n'est pas fortuite et répond au besoin de s'isoler pour se protéger d'attaques éventuelles. Les artisans redoutaient certainement, à tort ou à raison, l'hostilité ou la convoitise de concurrents ou des autochtones contrairement à d'autres pays européens. C'est un fait qu'il ne faut pas négliger pour apprécier l'état de la région au début du XIe siècle.