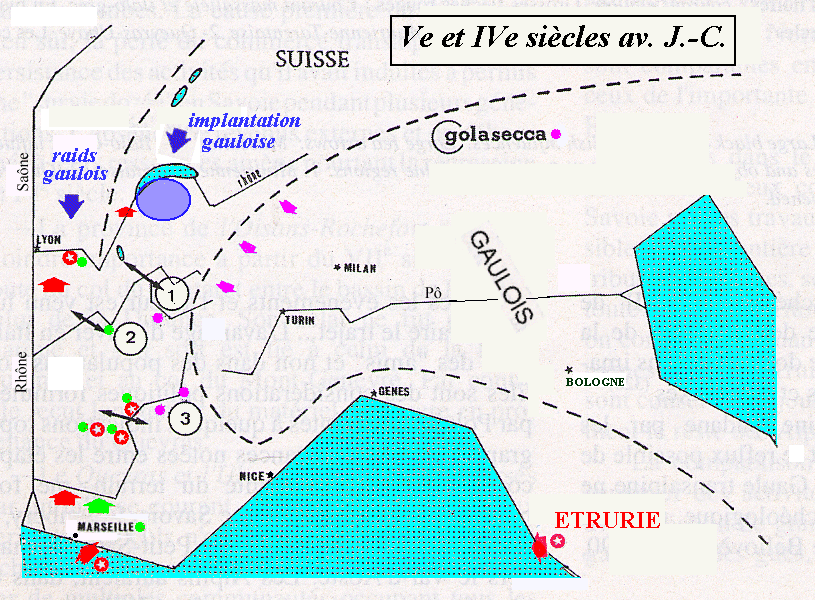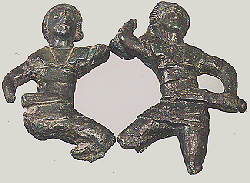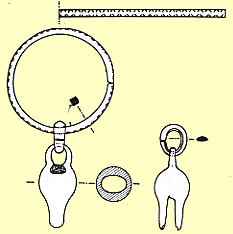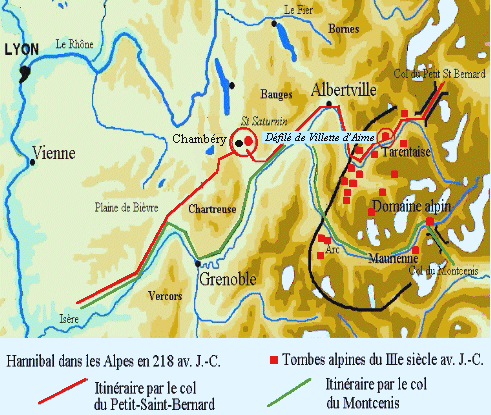
L'avant-pays
Le nord
de la Haute-Savoie a connu une implantation gauloise marquée par des cimetières
qui rassemblent hommes, guerriers et femmes à la Tène
ancienne III ainsi que par quelques bracelets (306).
Le plateau de Larina à Hières-sur-Amby est occupé aussi
par des Gaulois à la fin du IVe siècle, qui ont dû prendre
la succession des princes halls-tattiens, car un objet étrusque atteste
un haut rang social (306bis).
A la Tène moyenne
(307) les vestiges marquent seulement une présence militaire, mais ce
doit être que les sites d'habitat ont été bouleversés
ou négligés.
Présence militaire aussi à la Tène moyenne dans le massif
de Crémieu, en nord Dauphiné et au débouché de la cluse de Grenoble, avec
des tombes de guerriers (308) ; ceux-ci ont
pénétré jusqu'à la Combe de Savoie (309).
Dans plusieurs gisements
on a reconnu de la céramique gauloise, malheureusement ils restent à étudier
pour la plupart (310) afin mieux comprendre
la prise de possession du territoire et l'évolution du peuplement à partir
des IVe/IIIe siècles.
Cette présence gauloise est-elle en rapport avec la métallurgie du fer ? Les
preuves directes, comme des fours, scories, etc., sont très rares (311)
mais les régions calcaires du Salève et des monts du Chablais au nord, du
massif de Crémieu et du Royans au pied du Vercors possèdent abondamment des
sédiments sidérolithiques utilisés habituellement par la sidérurgie celtique
européenne (312).
Là encore, comme pour les minerais de cuivre à l'âge du Bronze, on est étonné
de la convergence entre présence des premiers Gaulois et ressources minérales.
Le commerce de l'avant-pays
Le sud de l'avant-pays poursuit ses échanges avec Marseille ; au Pègue, les
céramiques grecques sont assez nombreuses au début du IVe siècle mais la deuxième
moitié de ce siècle est la mieux représentée par les apports italiques: pré
campanienne et campanienne ont succédé à l'attique à figures rouges. Campaniennes
A et B et amphores massaliotes témoignent encore de l'importance de l'oppidum
de Larina à Hières-sur-Amby ; des campaniennes à Sassenage, près de Grenoble
et à Seyssel-Vens sur le haut Rhône jalonnent la route commerciale vers le
nord. Par contre l'influence phocéenne disparaît de la moyenne Durance, qui
semble désertée ou en nette régression économique sans que l'on comprenne
pourquoi.
Les
massifs internes
Après la conquête de la plaine du Pô vers 390 av. J.C., les Gaulois sont établis
de chaque côté des Alpes ; en Piémont leur empreinte est bien visible au sud
du fleuve Tessin où les contacts avec la civilisation de Golasecca se tarissent
au IVe siècle correspondant à une implantation seulement militaire, comme
à l'ouest des Alpes. En Val de Suse au IIIe siècle des tombes d'architecture
alpine contiennent quelques éléments gaulois (313)
sans que cela signifie une grande activité des cols.
En Savoie l'influence
de Golasecca (314) dans son faciès tessinois
continue. Les objets de la Tène ancienne II sont
absents à part un torque à Villarodin et les fibules Golasecca tessinoises.
La grande nécropole de Saint-Jean-de-Belleville est encore utilisée à la Tène
moyenne mais on n'y discerne pas de matériel caractéristique de la Tène ancienne
II.
En Tarentaise et en
Maurienne, seuls des objets gaulois de la Tène ancienne
III et la Tène moyenne complètent les mobiliers indigènes.
Encore est-il possible de faire une distinction entre les objets de la Tène
ancienne III (315) où les fibules de
Münsingen proviennent peut-être d'Italie du Nord et ceux de la Tène moyenne
(316) plus proches de l'aire occidentale helvétique,
ce qui se justifie par l'abandon de la Gaule cisalpine.
Les cols ont très naturellement été pratiqués puisque
chaque versant possède du mobilier gaulois. L'imprégna-
tion gauloise, la celtisation, de la Maurienne et surtout
de la Tarentaise fut plus importante que l'influence halls-
tattienne si on se fie à la quantité respective des vestiges.
Un fait majeur surprend, c'est la nette différence avec
les VIe-Ve siècles qui avaient vu fleurir à profusion les
productions locales complétées par quelques importations ;
à partir du IIIe siècle la population se réduit car le nom-
bre des cimetières et des tombes diminue, l'artisanat
alpin disparaît et la richesse semble s'éteindre.
Au sud, la région de l'Oisans-Rochefort est encore plus mal lotie : la rareté des restes laténiens montre sa mise à l'écart qui s'accompagne des mêmes conséquences qu'en Savoie.
La vallée de la Durance, vers le col du Montgenèvre, a pu servir au trafic mais il en reste peu de choses : le torque en argent de Freissinières-Pallon (près de l'Argentière!), spectaculaire copie indigène des modèles gaulois, quelques perles de la Tène moyenne dans une tombe aux Orres. Dans cette zone qui fut si riche et prospère jusqu'au Ve siècle, la Tène ancienne II et III et la Tène moyenne n'y sont pratiquement pas représentées. Absence de fouilles, abandon du territoire, crise économique, il faudra bien un jour expliquer cet hiatus.
Pour le Queyras-Ubaye,
un tout autre tableau doit être dressé, car l'empreinte gauloise, assez faible,
se fait sentir tardivement, pas avant le IIIe siècle ( au moment où
les tribus gauloises -Allobroges, Voconces, Caturiges, etc.- se mettent en
place).
Si les exubérantes productions locales des vallées du Guil et de l'Ubaye vont
être affectées du même déclin que celles de Savoie, ce sera avec deux siècles
de retard, seulement au cours du IIe siècle : en effet, à la Tène moyenne,
quelques éléments gaulois ( des fibules en général) sont encore
associés à de splendides et abondants mobiliers funéraires alpins.
Les haut-Alpins font preuve d'une grande richesse et d'originalité dans leurs
productions (317) au IVe, IIIe et probablement
encore au IIe siècle.
Quelques-uns de leurs bijoux s'exportent parfois fort loin (318),
et souvent dans les Alpes elles-mêmes. Des bracelets étroits et incisés
et des crotales issus du Queyras se retrouvent ainsi dans les Alpes internes
(Tarentaise-Maurienne, Oisans-Rochefort) ce qui indique la fréquentation des
cols qui relient entre elles les grandes vallées transalpines du versant occidental.
Comme en Savoie, un courant vient de l'Italie nord-alpine (civ. de Gola-secca)
à la Tène ancienne III (319).
Il est plus difficile
de préciser de quel versant des Alpes sont arrivés les bracelets serpentiformes,
les fibules "schéma la Tène II" de Guillestre ainsi que la mode des ceintures
de la Tène ancienne III et de la Tène moyenne
dont les Alpins imaginent des copies fort complexes (320).
La conquête de la plaine padane par les Romains, vers 220 av. J.C., et le reflux possible de quelques tribus celtes vers la Gaule transalpine ne se traduit par aucune trace archéologique, pas plus d'ailleurs que les passages de Bellovèse, vers 390, et d'Hannibal, en 218.
La passage d'Hannibal
en 218
L'itinéraire suivi pour la traversée des Alpes par l'armée d'Hannibal et ses
trente éléphants a fait couler beaucoup
d'encre et soulevé bien des hypothèses : cols du Montgenèvre, du Mont-Cenis,
du Clapier, du Petit-Saint-Bernard ? Les
textes de Tite-Live et de Polybe se contredisent souvent mais à notre sens
celui de ce dernier serait plus fiable et plus cohé-
rent ; il a été écrit moins de cent ans après les évènements et l'auteur est
venu luimême faire le trajet...
Quelques indications topographiques, les distances notées entre les étapes
comme les considérations politiques formulées
par Polybe me font préférer le tracé par la basse Savoie, Chambéry, la vallée
de l'Isère et le col du Petit-Saint-Bernard
vers le Val d'Aoste. Les Alpins ont, semble-t-il, fortement résisté dans les
défilés en aval d'Aime en profitant de la configuration du relief.
Evolution
de la civilisation alpine
La riche civilisation alpine, dont j'ai expliqué la mise en place différente
suivant les régions, s'éteint archéologiquement à la fin de la
Tène moyenne après la soumission des Allobroges par Rome. Est-ce là
la cause historique ou économique du déclin quasi définitif des provinces
des Alpes internes, déclin qui s'était étalé au cours
de l'évolution et qui ne s'est pas manifesté en même temps partout
: Ve siècle sur la Durance, IVe siècle en Savoie et en Oisans, IIIe-IIe siècle
en Queyras/Ubaye.
- Le Briançonnais et la voie du Montgenèvre étaient dominés dès la fin du
VIIIe siècle par la forte présence des Hallstattiens largement implantés dans
le Gapençais. Là peu de productions locales originales et richesse limitée
des tombes : les Hallstattiens sont maîtres de la région, de son organisation
et de ses activités. Le trafic transalpin s'interrompt au Ve siècle et c'est
immédiatement la chute brutale vers une certaine pauvreté et la survie probable
des populations dont pratiquement rien ne nous est parvenu.
- Les Alpins de Savoie avaient organisé eux-mêmes le trafic transalpin sous
l'égide et au bénéfice des Hallstattiens au VIIe siècle dans un contexte climatique
favorisant les productions locales tant pour la subsistance que pour l'exportation.
La mise en exploitation des mines de cuivre, d'argent ou de sel n'était pas
étrangère au développement.
Commerce "international" et activités régionales sont à la source de l'expansion
du peuplement et des richesses étalées dans les tombes. La cause première
du déclin est, bien sûr, la perte du commerce transalpin mais la persistance
des activités qu'il avait induites a permis une "survie dorée" en Savoie pendant
plusieurs générations. L'absence de revenus externes et de débouchés à leurs
ressources amène pourtant une certaine régression au IVe siècle.
- La province de l'Oisans-Rochefort a eu une moindre importance à partir du
VIIe siècle sur la route du col du Lautaret, entre le bassin de l'Isère et
celui de la Durance. Son éclat ne fut pas très marqué et son sort est lié
à celui de la haute Durance et au col du Montgenèvre. Par contre elle reçut
longtemps des parures en provenance du Queyras.
- Le Queyras et l'Ubaye n'ont pas été traversé par un intense courant commercial
entre les deux versants ; les cols n'ont eu qu'un intérêt local. La richesse
et l'extension progressive du peuplement, par de multiples communautés occupant
tous les espaces habitables à partir des VIIe/VIe siècles, sont dus plus à
une dynamique régionale qu'à des facteurs extérieurs. C'est ce qui explique
la persistance tardive d'un haut niveau de vie dans un contexte général peu
favorable, entre les IVe et IIIe/IIe siècles
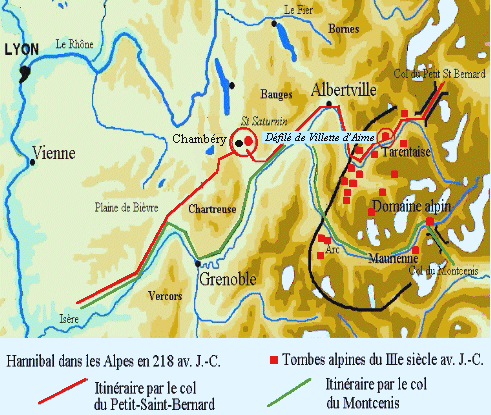

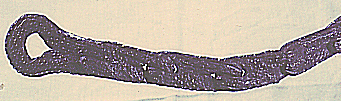


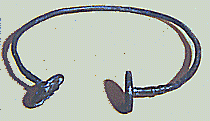
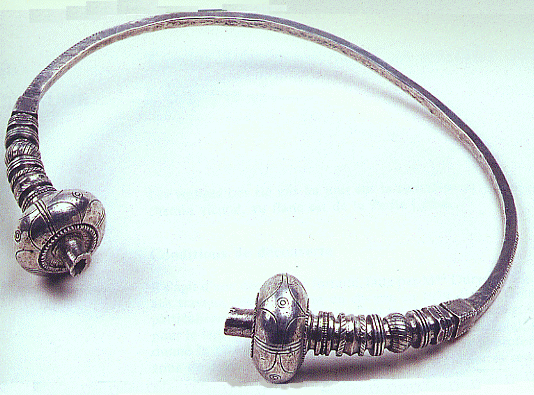

Mobilier caractéristique d'une inhumation
à Guillestre, Hautes-Alpes.
avec la diversité des bracelets, des boutons, des fibules, ceinture
et pendeloqie sont uniques.
La fibule à disque atteint sa plus excessive grandeur.
La tombe date de la fin de la Tène mais elle regroupe des objets bien
plus anciens.