
A partir du VIIIe siècle, le monde hallstattien et l'Italie augmentent leurs échanges: attraits du mode de vie fastueux et des produits de luxe pour les uns, besoin de matière première (cuivre, étain, produits agricoles, etc.) et de débouchés commerciaux (vin, bijoux, etc.) pour les autres.
L'expansion hallstattienne,
dans sa marche vers le sud et les rivages méditerranéens en contournant les
Alpes par l'ouest, diffusera dans l'avant-pays ; en même temps elle assurera
le contrôle des voies et des cols vers l'Italie, indispensables au trafic
transalpin avant la création des ports par les Grecs au début du VIe siècle.
Le courant hallstattien pénétrera les Alpes suivant des modalités différentes.
Les zones de piedmont au relief adouci en présenteront une imprégnation diffuse;
les agriculteurs semblent avoir un peu déserté ces régions laissant aux pasteurs
les libres espaces ouverts du plateau savoyard où le climat plus humide du
début du Sub-Boréal favorisait la croissance des pâturages. Dans le coeur
des Alpes, vers l'Italie, les Hallstattiens seront intéressés
par les voies ouvertes au cours des époques antérieures.
Deux types de prise de contrôle les affecteront : celui appliqué à la Maurienne,
à la Tarentaise, à l'Oisans, à l'Ubaye et au Guil sera totalement différent
de celui qu'a connu la moyenne Durance et le Buech vers le col du Montgenèvre
qui fut véritablement colonisé.
L'avant-pays
La hallstattisation de la partie nord de la région semble plus tardive que
celle de la partie sud, contemporaine de celle du Languedoc à partir du VIIIe
siècle. Les premiers éléments purement hallstattiens sont les épées de bronze
à soie plate qui révèlent une présence militaire, à la fin du VIIIe siècle,
tout le long du couloir rhodanien en direction du Midi, particulièrement dans
les Baronnies (273).
Les importations italiques dans l'avant-pays datées de la fin du VIIIe et
du début du VIIe siècle, proviennent d'Italie centrale ou orientale (274)
et peu de la sphère nord-alpine (275).
Comme nous l'avons vu au chapitre précédent, il est difficile de faire la part chronologique entre ce qui revient à la fin de l'âge du Bronze et celle du début du Premier âge du Fer.
Au sud du lac Léman,
à Fillinges, sept cuirasses du VIIIe siècle issues des ateliers du Danube
formant un dépôt (?), une épée de type Gündlingen à Crémieu en nord Dauphiné
et une cuirasse à Grenoble révèlent une présence militaire comme on l'a vu.
La région de la moyenne Durance et du Buech subit une véritable colonisation
par des communautés hallstattiennes arrivées probablement depuis la vallée
du Rhône par le col de Saulce (276) et qui
s'implanteront dans le Midi à l'ouest du Rhône: en effet le mobilier du tumulus
5 de Chabestan a une saveur voisine de celui de certains tumulus de Mailhac
et du Languedoc (277). La nécropole tumulaire
installée à la fin de l'âge du Bronze sur la terrasse du Buëch à Chabestan
prend alors de l'ampleur et d'autres essaiment aux alentours
(278).
La route du Montgenèvre
est ainsi contrôlée par une aristocratie hallstattienne riche qui échange
avec l'Italie (279) en prenant vraisemblablement
la suite de celle qui dominait à la fin de l'âge du Bronze pour les mêmes
raisons commerciales. Mais la présence hallstattienne en fond de vallée n'empêche
pas des "indigènes" d'habiter les coteaux ou les vallons environnants et d'acheter
les armilles hallstattiennes qui abondent dans leurs tombes plates entourées
de pierres, suivant la pure tradition alpine
(280) que l'on verra.
Les grottes du Diois ne sont pas avares en céramiques de cette époque même
si les caractères hallstattiens sont encore fugaces comme aux Gandus, à Saint-Ferréol-Trente-Pas.
Bien que le fer soit
utilisé pour quelques bijoux et quelques outils ou armes, il n'existe aucune
preuve alpine de cette métallurgie ; le métal affiné devait provenir d'ailleurs.
Les analyses du Pègue montrent que le fer hallstattien ne provient pas de
la région, qu'il est plus pur et plus dur que le fer gaulois élaboré, plus
tard, sur place à partir des minerais locaux.
Les massifs internes
A l'intérieur des massifs internes du nord et du sud il n'y a pas installation
de "colonies" hallstattiennes, seulement une présence
rare et épisodique parmi les Alpins dont les activités agro-pas-
torales s'intensifient, comme l'indiquent les pollens de céréales
dans la tourbière de la Soie en Maurienne à partir des VIIIe/VIIe siècles.
Le plus ancien témoin
de l'âge du fer à l'intérieur des Alpes est le rasoir
villanovien de Pralognan de la fin du VIIIe siècle.
- La haute vallée de l'Isère est marquée par un seul tumulus aux Allues et
celle de l'Arc par un tumulus à incinération à Villarodin-Bourget avec une
fibule villanovienne de la fin du VIIIe siècle ; là, la présence de
galène "votive" dans le mobilier funéraire halstattien n'est pas fortuite
car la tombe se trouve au pied d'une mine de plomb argentifère et pourrait
être celle d'un responsable de l'exploitation.
- Au sud de Grenoble le plateau de la Matheysine, à La Motte-d'Aveillans,
possédait quelques tombes avec des pendeloques venues du Picenum, en Italie
orientale, datées du VIIe siècle, des bracelets hallstattiens en tube de bronze
et des bracelets gravés de type alpin (Queyras ?).
- La vallée du Guil a été aussi parcourue par quelques Hallstattiens qui ont
laissé un seul tumulus à Ristolas, au pied du col de la Croix, sur une voie
vers l'Italie, mais ni le reste du Queyras ni l'Ubaye ne possèdent de mobilier
hallstattien ancien.
Tous ces très rares tumulus hallstattiens qui jalonnent les routes intra-alpines
principales vers l'Italie, datent du début de la période (VIIe siècle)
et ne semblent plus utilisés au VIe siècle. C'est un fait important qui traduit
l'évolution des rapports entre Alpins et Hallstattiens : ceux-ci ne pénètrent
plus eux-mêmes dans l'intérieur des Alpes une fois que l'organisation
technique et humaine du trafic fonctionne à leur convenance.
Par la suite seuls des bijoux attestent la persistance des contacts entre
gens des plaines et gens de la montagne ; s'il y a eu persistance du contrôle
par les Hallstattiens, leur présence permanente n'était plus nécessaire, d'autant
que la vie en haute montagne ne satisfaisait ni leurs troupeaux, ni leur économie,
ni leurs goûts.
Le commerce
de 700 à 550 av. J.C
Les importations italiques, assez nombreuses dans l'avant-pays à la
fin du VIIIe et au début du VIIe siècle, proviennent d'Italie centrale et
orientale et peu de la sphère hallstattienne nord-alpine.
Dans la plaine de Bièvre-Valloire
à la Côte-Saint-André, Isère, un grand tumulus contenait un char cultuel,
dont les roues en bronze datent du Bronze final, mais qui portait un bassin
et une situle italiques du VIIe/VIe siècle.
Du trafic commercial, les provinces alpines conservent pour leur
usage quelques pièces provenant d'Italie orientale (281),
centrale (282) et aussi de Golasecca (283)
pour la Maurienne et l'Oisans, ce qui traduit le contact avec les Alpins italiques
et pas seulement avec les premiers
Etrusques.
LA PÉRIODE DU HALLSTATT FINAL ET LA TENE ANCIENNE I
de 550 à 400 av. J.C.
La puissance étrusque
s'accroît en s'implantant dans la plaine du Pô, l'échiquier politique et économique
autour des Alpes s'en retrouvera modifié.
Les premiers "raids" gaulois au début du Ve siècle dans l'avant-pays ne modifieront
en rien la vie dans les zones alpines. Un changement se constatera seulement
au moment de l'invasion gauloise de la plaine du Pô, au début du IVe siècle.
L'avant-pays
- Dans le massif de Crémieu une colonie hallstattienne qui a pris la suite
des "princes" du Bronze final, a des contacts avec les Etrusques (284)
aux VIe et Ve siècles. La région se prêtait aux déplacements des troupeaux
et de plus le massif constitue une forteresse naturelle placée à l'intersection
des grands axes est-ouest et nord-sud (285)
qui donnent toute son importance à l'oppidum de Larina, Hières-sur-Amby. -
Au VIe siècle, l'avant-pays savoyard connaît une
"hallstattisation" dont l'ampleur n'atteindra pas celle, plus ancienne, que
nous avons vue se développer sur la moyenne Durance. Son origine se trouve
sur le plateau suisse et au pied oriental du Jura. Les bords du lac Léman
et de l'Arve (286) possèdent des sépultures
avec fibules, brassards-tonneau ou parures ventrales dans la pure tradition
hallstattienne ; dans le bassin d'Annecy il y a quelques tumulus et des sépultures
non précisées (287). Rappelons
qu'en Chablais comme dans la région d'Annecy il y a des ressources en cuivre,
mais y a-t-il un lien entre présence hallstattienne et minerai ?
- Ailleurs dans l'avant-pays quelques gisements ont des
niveaux datés typologiquement de cette période avec
du matériel indigène, preuve de la continuité de l'occupation
(288) ; les éléments typiquement hallstattiens y sont très rares.
C'est Le Pègue, dans
le sud de la Drôme, magistralement étudié par C.Lagrand, qui constitue le
site le plus important et le plus riche en enseignement : la colline Saint-Marcel
est occupée par une population indigène très fortement influencée ou dominée
par les Hallstattiens qui en font une base de commerce avec Marseille dès
la deuxième moitié du VIe siècle.
Le Pègue va se faire une spécialité dans la production de céramique "pseudo-ionienne"
; sa fonction d'habitat et de centre artisanal sera complétée par une activité
religieuse ou cultuelle comme en témoignent les stèles réemployées plus tard
dans des murs gaulois.
- Au VIe siècle sur la moyenne Durance, les Hallstattiens abandonnent le commerce avec l'Italie au profit d'échanges avec le Midi méditer-ranéen. A Sainte-Colombe, près du Buech, le village accroché à la pente offre l'exemple du mélange des matériels et des traditions indigènes et hallstattiens comme l'a démontré J.C Courtois ; cette communauté noue des liens tant avec la Franche-Comté et la haute Seine (289) qu'avec les comptoirs de Marseille qui lui fournissent céramiques phocéennes, étrusques et grecques au cours du VIe siècle.
L'avant-pays alpin et la moyenne Durance font partie de la mouvance hallstattienne et participent aux échanges à l'intérieur même de ce monde ; les paysans autochtones font preuve de peu d'originalité avec une céramique banale et ils se fondent dans un nouveau type de société.
Au Ve siècle les Gaulois, vers 480 av. J.C. détruiront les places fortes (290) et les riches villages bien intégrés dans le système hallstattien et dans le commerce avec Marseille comme le Pègue et Sainte-Colombe, seront abandonnés.
Pour le reste de l'avant-pays,
les indigènes subiront sans heurt apparent les nouvelles influences ou la
domination gauloise : dans la région d'Annecy il y a continuité dans l'emploi
des tumulus de Gruffy. La tombe de Saint-Laurent-en-Royans (291)
indique la présence de soldats dès le Ve siècle en nord Dauphiné et au pied
occidental du Vercors.
Les
massifs internes
C'est à partir du VIe siècle que s'individualisent fortement les grandes "provinces"
alpines Maurienne-Tarentaise, Oisans-Rochefort et Queyras-Ubaye, le Champsaur-Briançonnais
ne présentent pas une forte identité étant très ouvert sur les Hallstattiens
du Gapençais.
L'origine doit s'en trouver dans les activités liées au trafic
intense entre le couloir rhodanien et l'Italie par les cols et aussi dans
lexploitation des ressources naturelles et agricoles (292).
Vente et portage des marchandises sur des chemins qu'ils connaissaient bien,
ont procuré de bonnes rémunérations : un dynamisme jusqu'alors inconnu prend
naissance qui aura un développement exceptionnel à l'intérieur des Alpes (293).
- Dans les hautes vallées de Savoie : Maurienne et Tarentaise.
Les Hallstattiens continuent leur commerce avec les Alpins, de la moitié du
VIe au début du Ve siècle, avec des intensités diverses suivant les régions.
Les VIe et Ve siècles voient l'extension et l'apogée de la richesse
du groupe de Maurienne-Tarentaise avec la création d'un artisanat local abondant
et varié (294). Ces productions sont complétées
par quelques bijoux (295) hallstattiens issus
de la sphère occidentale (296) et par l'ambre
venue de la Baltique par les cols italo-helvétiques et le relais de la région
de Golasecca.
Mais plus aucun matériel ne parvient de l'Italie étrusque. Ce développement
correspond à celui qui affecte la zone de Golasecca lié au commerce, et en
Savoie on est en droit d'évoquer les mêmes raisons pour une richesse induite
en partie par le trafic transalpin.
R.Peroni attribue l'éclat de l'aire de Golasecca au VIe siècle, plus à la
qualité de son peuplement qu'au commerce avec les Etrusques ; l'archéologie
des vallées savoyardes inciterait à penser de même pour cette période et c'est
seulement plus tard, que leur mise à l'écart s'accompagnera de leur appauvrissement
culturel et matériel. Soulignons les remarques de F.Gambari qui décèle dans
le Piémont occidental, la persistance des contacts avec "le monde hallstattien
alpin et transalpin" plus nets que ceux d'origine padane (297).
- Bien que nettement moins riche, le groupe Oisans- Rochefort suit la même évolution avec des bracelets indigènes à fausse torsade associés à quelques bracelets hallstattiens de fer et de lignite (299).
Si la
région de Grenoble ne connaît pas de véritables établissements
hallstattiens comparables celles de l'avant-pays, les influences sont pourtant
bien nettes.
Les Alpins s'implantent dans l'Oisans autour et sur la route du col du Lautaret
vers la haute Durance qui est jalonnée par des tombes en coffre de pierre
de type alpin au riche mobilier d'ambre (300)
et de bracelets alpins mélangés à d'autres de type hallstattien
et à quelques importations de Golasecca.
- Dans le sud, le groupe du Queyras-Ubaye, très isolé dans ses vallées, possède quelques rares bracelets hallstattiens (Ubaye, Vars, Jausiers), aucune fibule et peu d'ambre ; cette région a encore peu de contact avec la sphère de Golasecca contrairement à la Savoie. La production locale se manifeste dans de lourds bracelets à côtes (à Jausiers) et d'innombrables anneaux étroits décorés de d'incisions marginales, empilés pour former des brassards, dont la mode et la fabrication persisteront longtemps.
De l'autre coté de la ligne des crêtes et du col de la Croix, à Crissolo dans la haute vallée du Pô, des tombes en coffre contenaient des fibules italiques, des bracelets alpins et aussi des bracelets hallstat-tiens identiques à ceux que possèdent les tumulus de Chabestan ; le versant italien est bien incorporé à la province alpine.
Les importations italiques
se restreignent à la fin du VIe et au début du Ve siècle (301)
et se limitent à la sphère Golasecca du Tessin.
Les Alpins du sud commencent à copier très librement les fibules serpentiformes
à disque pour créer leurs grandes fibules discoïdes qu'ils portaient sur la
tête et qui prendront de grandes proportions par la suite (302).
Le
commerce de 550 à 400 av. J.C.
Durant cette période, les voies transalpines occidentales ne sont plus fréquentées
pour des raisons liées probablement à des changements de stratégie commerciale
; mais il ne faut pas oublier les difficultés nées de la péjoration climatique
limitant la durée annuelle de possibilité de passage des cols. L'arrêt des
échanges transalpins entre le monde occidental et l'Italie centrale ou padane
n'a pas de conséquences immédiates. La prospérité de la "civilisation alpine"
n'est pas liée seulement au trafic "international" à travers les cols ; celui-ci
a seulement facilité l'expansion alpine au VIIe et au VIe siècle, à la faveur
d'un climat amélioré.
Les ressources locales
ont été largement échangées de part et d'autre des Alpes : si les bijoux non
alpins, hallstattiens et italiques en témoignent, ils accompagnent les productions
locales dans une richesse ostensiblement étalée dans les tombes.
Si les Etrusques ont commercé avec le Midi dès le milieu du VIIe siècle ce
n'est qu'au cours du VIe siècle que s'installe un courant vers le nord par
la vallée du Rhône et ses abords (303) : à
partir de 600 av. J.C., c'est Marseille qui monopolisera les échanges entre
le monde gréco-étrusque et l'Occident. Ce courant avec ses produits de luxe
qui remonte vers l'est de la France, la Suisse et le haut Danube (304)
est trop connu pour qu'il soit nécessaire d'insister. Des pointes de flèches
grecques à trois ailerons du VIe siècle ont dû suivre la même voie
(305).
Mais au Ve siècle, Marseille
sera en crise, à la suite de l'écroulement du système commercial hallstattien
sous les coups des premières incursions gauloises ; un autre système le remplacera
plus tard suivant d'autres réalités géopolitiques ou économiques.
La destruction du Pègue vers 480 av. J.C. sera suivie d'une période obscure
et les importations grecques y figureront de nouveau seulement à la fin du
Ve siècle.


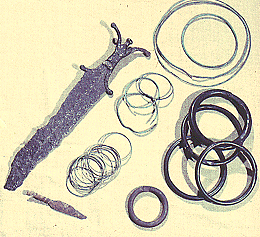



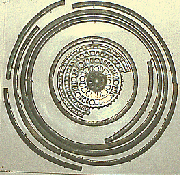


Coupe hallstattienne à décor
géométrique gravé du VIe siècle
et céramique attique à figure rouge du Ve Siècle. Le
Pègue, Drôme.














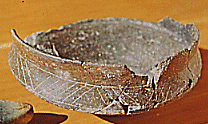

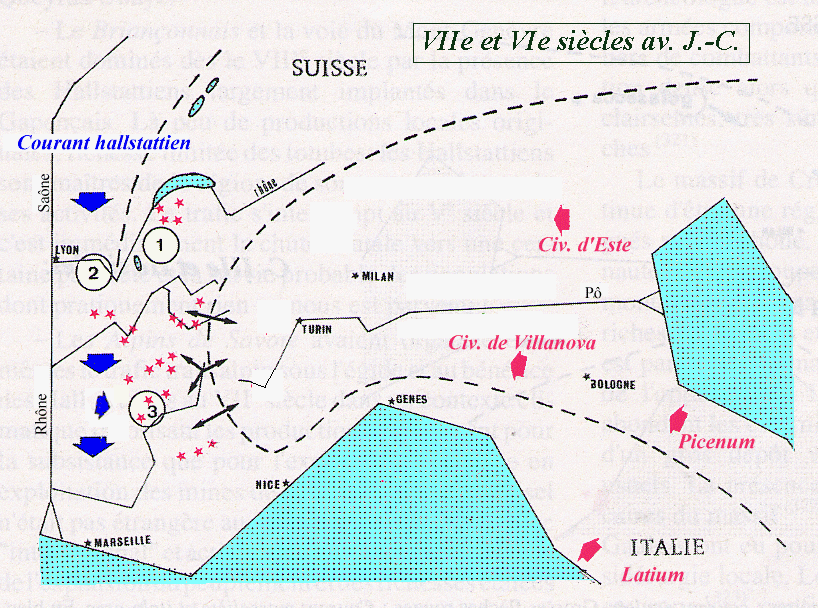
Groupes hallstattiens
1 - Région de Haute-Savoie
2 - Région de Crémieu
3 - Buech-Durance


