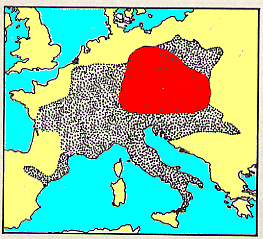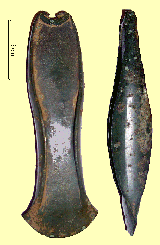Les XIVe et XIIIe siècles
av. J.-C. forment une période particulièrement intéressante dans les Alpes
du Nord parce que les mentalités et les techniques subissent d'importantes
modifications dans la mouvance de celles qui affectent toute l'Europe.
Les temps modernes protohistoriques commencent avec l'émergence de l'originalité
alpine à l'intérieur de ce qui fut appelé la Civilisation des Champs
d'Urnes (des urnes contenant les cendres d'incinérations étaient
enterrées dans un espace mortuaire : le champ d'urnes.)
Amélioration
climatique
Au début de la première phase du Bronze final
alpin une amélioration climatique corrige progressivement les effets
réducteurs de l'ambiance froide et humide du Bronze moyen.
A Seyssinet les céréales réapparaissent dans les pollens
et le cheptel se diversifie de nouveau ; l'expansion territoriale en montagne
s'en trouvera facilitée.
Les grands décapages d'autoroutes ont livré les restes de nombreux
villages de cette phase, preuve évidente de nouvelles implantations dans des
zones délaissées qui vont reprendre vigueur. Le substrat culturel, technique
et très probablement humain des Alpes du Nord va se modifier en quelques siècles
avec une rupture nette dans les traditions en place depuis le Néolithique,
alors que celles-ci avaient lentement évolué en assimilant les influences
exogènes successives.
Il y a rupture complète
et brutale dans le matériel
Dès le XIVe siècle apparaît parmi le matériel archéologique une "rupture
typologique majeure" avec de toutes nouvelles formes de bronzes
et de céramiques fines ou grossières (155),
traduisant un renouvellement complet des techniques de base. Même la céramique
domestique qui conserve habituellement longtemps ses caractères traditionnels,
se transforme aussi (156). C'est assez dire
que des influences se font prégnantes signant autre chose que de simples contacts
commerciaux.
La diffusion de ces nouveautés se fera à partir de l'est et du centre-est
de la France et dans leur mouvement vers le sud, elles atteindront la vallée
du Buech, le Gapençais en laissant de nombreux témoins sur leur route.
Acculturation ou migrations, la question n'est pas facile à régler. Doit-on
les changements à la diffusion d'un peuplement s'infiltrant parmi des
communautés indigènes peu nombreuses, qui perdent leurs toutes leurs habitudes
techniques mais conservent le rite de l'inhumation en grotte, ou bien assiste-t-on
seulement à une acculturation induite par de très petits groupes de
migrants ? Il n'est pas encore possible de le savoir, les deux processus ayant
très bien pu coexister, en étant complémen-
taires.
Devant plusieurs évidences déjà évoquées je pencherais plutôt pour le "déplacement"
de groupes de migrants dynamiques, ne comportant par forcément beaucoup
d'individus, qui recolonisent un territoire (157)
ou réinfiltrent des communautés affaiblies par deux siècles
de régression, comme on l'a vu. Les dates absolues sont rares, deux étant
fournies par les sites stra-
tifiés de Seyssinet, près de Grenoble (1240 BC avec de la céramique à cannelures
légères), Creys-Mépieu en nord Dauphiné (1160 BC) et Jons près de Lyon avec
une tasse à anse ad ascia des Terramare d'Italie du Nord (1350 BC)
(158).
Les
influences exogènes
Pour dater et classer le matériel qui apparaît après le Bronze
moyen il serait nécessaire de prendre chaque objet pour en faire
une typologie chronologique fine afin de mettre en évidence des séquences
d'évolution ; ce n'est pas le lieu ici où nous nous contentons d'interpréter
les grands changements.
Les premières influences venues du nord
ou du nord-est imprègnent, au XIVe siècle, le couloir rhodanien en direction
de la Provence (159). Quelques vases à la
Balme en Savoie, la Balme-les-Grottes et un couteau à Chamagnieu (160)
en Isère, toutes près du Rhône, s'intègrent bien à ce mouvement ainsi que
le pichet à décor cannelé de Chastel-Arnaud en Diois. Mais la céramique propre
à ce courant initial ne pénètre pas à l'intérieur même des Alpes du
Nord ; seulement quelques bronzes arrivent en Savoie occidentale (161)
ce qui ne nous éloigne pas beaucoup du couloir rhodanien.
Cette étape correspond au "Bronze récent" défini par J.Vital
pour Donzère et la basse vallée du Rhône.
La progression des influences se suit de la même manière avec la céramique
à cannelures légères en habitat comme en sépulture jusque dans les Hautes-Alpes
(162).
Formes et décors ne sont pas seuls à changer, la texture des pâtes aussi.
Les coupes apodes et les urnes fines portant des cannelures légères ont un
dégraissant sableux homométrique, une teinte bistre ; certaines urnes présentent
une couverte sombre à base rougeâtre, desquamante, qui caractérise une technique
de fabrication inconnue jusqu'alors (163).
Toute-
fois à mesure que le temps avance les pâtes deviendront plus "classiques",
plus dures.
Une avancée spectaculaire
dans les procédés de fabrication des bronzes
Céramiques nouvelles, bronzes nouveaux, cela traduit à l'évidence le début
de la mutation techno-culturelle, en particulier dans la maîtrise des
arts du feu, qui s'affirmera dans les Alpes durant les siècles ultérieurs.
Une autre caractéristique de cette phase ancienne est mise en évidence par
les analyses des bronzes (164) qui montrent
que, comme dans toute l'Europe occidentale, leur teneur en impuretés est très
faible, traduisant la maîtrise d'une bonne technique d'affinage, dans
des centres très spécialisés, et vraisemblablement le
même type de minerai. Là encore il y a rupture par rapport aux périodes antérieures.
Dans la plupart des dépôts alpins, toutes les pièces sont fragmentées volontairement
en petits morceaux (165), comme c'est le cas
dans de nombreux dépôts de cette époque tant en France qu'en pays germaniques
(166). Il n'y a pas de raison technique pour
un tel morcellement et on se trouverait devant des trésors de "proto-monnaie"
qui deviendrait nécessaire à un commerce en expansion et pour lequel le troc
ne peut plus résoudre toutes les transactions ; cela traduirait des changements
dans la pratique et le volume des échanges.
Des
villages existent-ils déjà au bord des lacs alpins ?
Classiquement, dans l'est de la France et en Suisse occidentale on admet que
les premiers villages lacustres du Bronze final ont été construits au XIe
siècle, durant la phase moyenne du Bronze final alpin, mais certains vestiges
obligent à de nouvelles réflexions. Des épingles des XIIIe et XIIe siècles
proviennent des vieux ramassages effectués dans les stations lacustres (167)
; cela reste énigmatique même pour la Suisse où des observations identiques
ont été faites.
Le cas de la station immergée du Port à Annecy ajoute encore au trouble avec
la présence de céramique à cannelures légères et un niveau organique daté
de 1260 BC (168) : est-on en présence d'un
habitat littoral, c'est probable ?
Avant les grandes sécheresses de la fin de l'âge du Bronze marquées au lac
du Bourget par une forte régression, le niveau moyen du lac était de 1m70
en dessus de celui du début du Bronze final: d'éventuels villages littoraux
de cette époque seraient alors placés plus haut que ceux d'âge ultérieur installés
sur la rive après la baisse du plan d'eau. Ils n'auraient donc pas été protégés
postérieurement par la montée des eaux et reposeraient aujourd'hui sous les
sédiments non immergés des rivages.
Si tel était le cas, l'installation de centres de productions métalliques
et céramiques dans les Alpes du Nord et en Suisse occidentale serait quasi
contemporaine de ceux d'Europe moyenne et de Lombardie, accentuant encore
l'unité des régions touchées par les changements du début de l'âge du Bronze
final. Voilà des recherches à envisager...
Les contacts avec l'Italie
J'insisterai sur l'importance que prennent alors les cols transalpins dans
les échanges entre l'Europe occidentale et l'Italie du Nord qui se marquent
tant par l'importation de bronzes et de
céramiques que par les influences qui se retrouveront sur les productions
locales, entre autre la forme des haches.
En effet la voie vers l'Italie entre le Sillon alpin et le col du Petit-Saint-Bernard
est maintenant bien ouverte (169) ; les cols
du Mont-Cenis fonctionnent aussi.
Formant un exceptionnel dépôt, sept vases jamais utilisés directement issus
de la civilisation proto-Golasecca de Canegrate, seront empilés dans une fosse
en l'absence de tout habitat à 1300m d'altitude à Ste-Marie-du-Mont
dans le Grésivaudan (170). L'influence de
Canegrate est reconnue sur une urne biconique à carène torse de Fontaine et
aussi sur plusieurs de Sollières en Maurienne.
Néanmoins le rite d'incinération lié à ce faciès italique ne nous atteint
pas, ce qui montre simplement que les échanges sont limités au matériel.
Les bronzes lombards (171) apparaissent avec
six épées de types "Monza, Trana, Terontola" ou assimilés et quelques autres
objets (172). Le nombre de ces armes en provenance
d'Italie du Nord ainsi que celui des fragments d'épées présents dans tous
les dépôts (173) est surprenant. Ce phénomène
est inhabituel pour les Alpes, même ultérieurement ; doit-il être relié à
une "aristocratie" renaissante en rapport avec les premiers métallurgistes
et/ou le commerce de l'étain occidental dont l'Italie du Nord a besoin ?
Commerce de l'étain
avec la Normandie
Dans les Alpes la première trace accompagnant ce trafic de l'étain, indispensable
aussi à la métallurgie régionale qui s'installe, est représentée par cinq
haches à talon de type normand du début du Bronze final, disséminées du nord
au sud de la région (174).
L'absence de types bretons contemporains serait l'indice de la provenance
britannique de l'étain par la voie de la Seine.
Premières productions métalliques alpines
Nous avons vu qu'à la fin du Bronze moyen des bronziers ambulants témoignaient
d'une "décentralisation" des productions métalliques, autorisant ainsi l'éclosion
d'ateliers locaux par la diffusion d'un savoir faire et de techniques jusqu'alors
réservés à quelques spécialistes rassemblés en grosses unités.
Dans les Alpes du Nord j'ai été intrigué par la présence de bronzes qui n'appartiennent
pas à la panoplie de ceux largement diffusée en Europe occidentale d'origine
médio-européenne ou italique.
Leur originalité et leur densité m'a amené
à envisager en 1976 l'existence d'ateliers métallurgiques régionaux dès le
début du Bronze final.
Une hache de forme inconnue jusqu'alors, à ailerons médians allongés (175),
apparaît montrant certaines ressemblances avec des exemplaires d'Italie du
Nord bien que nous ne disposions pas, pour en juger, de tout le matériel italique
(176).
Il y a 30 ans je pensais qu'on se trouvait devant des productions locales
inspirés d'Italie du Nord ; des résultats d'analyses récentes ne sont pas
assez significatifs pour remettre en question cette hypothèse (177),
toute-
fois il faut quand même envisager l'importation de haches d'Italie du Nord
parallèlement aux épées comme nous l'avons vu.
Des bronziers autochtones auraient alors copié ces modèles italiques comme
ils ont copié, mais en taille plus faible, les haches rectangulaires à ailerons
médians courts européennes (178). Dans le
dépôt de la Balme, Savoie, une hache de chaque type (179)
était associée à deux bracelets ; plus d'une dizaine de trouvailles isolées
de haches ou de bracelets parsèment la région entre le lac Léman et les Hautes-Alpes
(180), à l'exception de la Drôme.
La contemporanéïté des deux métallurgies est manifeste dans les dépôts de
Lullin-Couvaloup, Haute-Savoie, de Vernaison et de Reventin-Vaugris sur le
Rhône, ce qui démontre que les marchés sont abondés par les deux productions.
Le Piémont possède à Pignerol un lot tout à fait identique à celui du dépôt
de la Balme, prouvant que les échanges Alpes du Nord-Italie s'opèrent dans
les deux sens.
Des bracelets, à section en V ou en D à faibles tampons, portent un décor
gravé avec arcs de cercles, hachures et pointillés (181)
que le goût indigène apprécie depuis la fin du Bronze moyen comme on l'a vu
; ils ne sont pas sans rappeler certains motifs de Canegrate, ce qui conforte
encore les échanges transalpins d'idées ou/et de productions.
Quand cette métallurgie alpine a-t-elle commencé ? Les associations en dépôt
nous font admettre le XIIIe siècle, au moment de la diffusion des nouveaux
types centre-européens (182) et de la complète
ouverture des passages alpins vers l'ouest qui ont permis des contacts faciles
avec l'Italie.
La naissance et le développement de la métallurgie alpine seront mieux connus
par des analyses systématiques de bronze tant alpin qu'italique et de nouvelles
études fines du matériel.


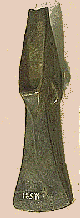
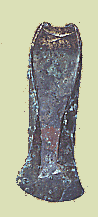

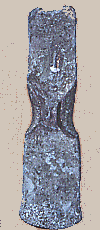
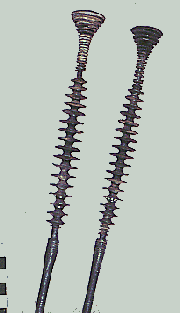
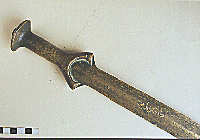
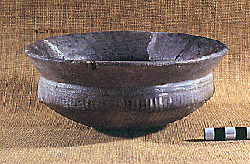
Coupe apode et grande urne biconique décorées
de cannelures légères, caractéristiques du début
de la civilisation des Champs d'Urnes.
Villard-de-Lans et Fontaine, Isère.